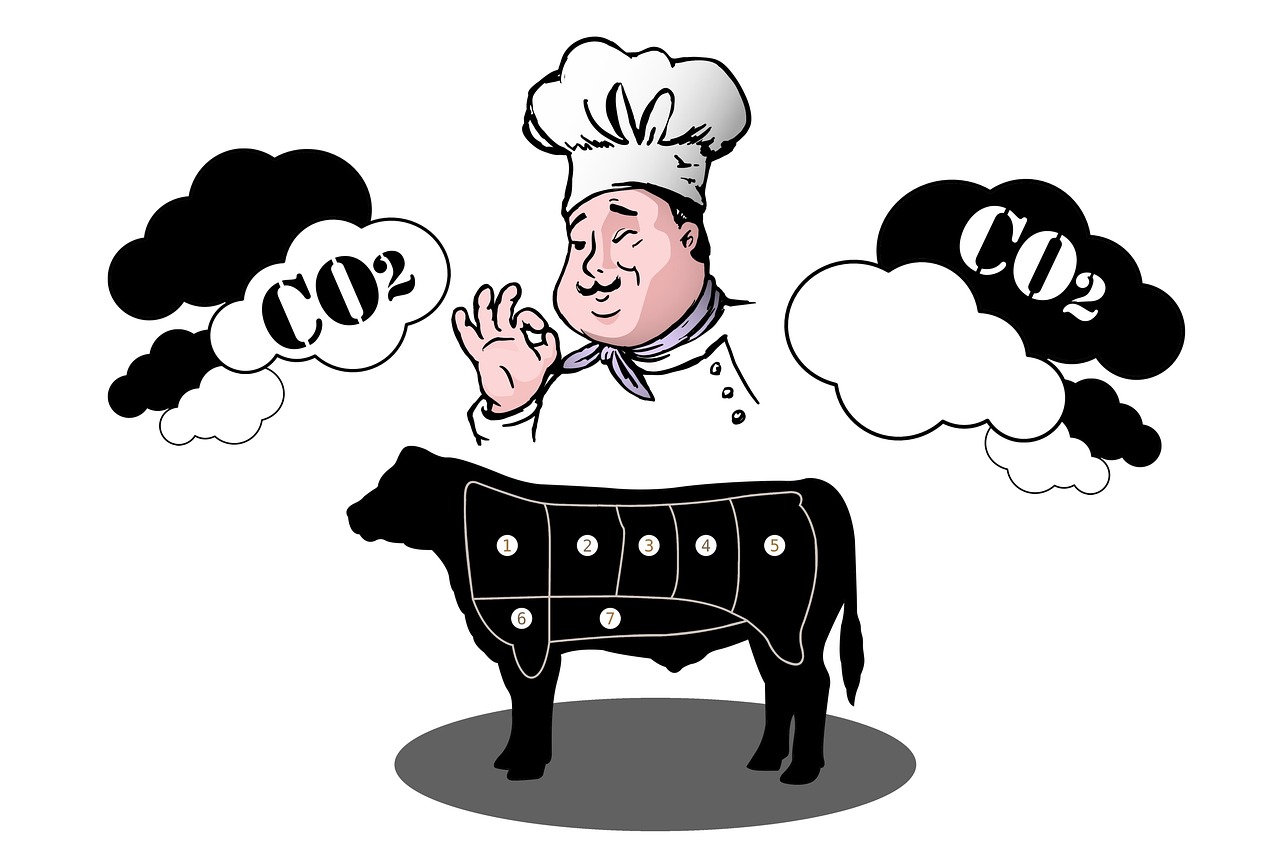|
EN BREF
|
L’Université de Montréal a récemment dévoilé son premier bilan carbone vérifié, portant sur l’année 2022-2023. Ce rapport met en lumière un total d’environ 63 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone émis, réparties sur trois périmètres d’activités. Parmi les principales sources d’émissions figurent le chauffage au gaz naturel et les déplacements des usagers. Pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions, l’université prévoit une baisse de 20% d’ici 2025 et aspire à une carboneutralité d’ici 2040. Les données, recueillies à travers ses différents campus, ont été analysées par l’Unité du développement durable et certifiées par un vérificateur externe.
Récemment, l’Université de Montréal (UdeM) a franchi une étape significative dans son engagement envers le développement durable en dévoilant son premier bilan carbone vérifié. Ce document d’une importance capitale présente une évaluation détaillée des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’université pour l’année 2022-2023, compilant des données issues de divers périmètres d’activités. À travers cette initiative, l’UdeM entend non seulement faire le point sur ses émissions, mais également définir un chemin vers la carboneutralité d’ici 2040.
Un audit complet des émissions de GES
Le bilan récemment publié révèle que l’UdeM a émis plus de 63 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (t éq. CO2) pour l’année 2022-2023. Cette mesure comprend des émissions directes et indirectes, couvrant ainsi une large gamme d’activités et de sources. L’évaluation s’axe sur trois périmètres principaux : les émissions directes, l’électricité achetée, et les émissions indirectes résultant des divers déplacements et des approvisionnements.
Répartition des émissions dans différents périmètres
En analysant les émissions directes, on constate qu’elles totalisent environ 28 400 t éq. CO2. Parmi celles-ci, le chauffage au gaz naturel est la source prédominante, représentant à lui seul près de 26 852 t éq. CO2. Les fuites des systèmes de réfrigération et les véhicules de service ajoutent également aux résultats, bien que dans des proportions moindres.
Le second périmètre, qui prend en compte l’électricité achetée, affiche un total de 254 t éq. CO2. Ce chiffre est satisfaisant et est en grande partie attribuable à l’utilisation d’hydroélectricité québécoise, qui réduit considérablement le bilan carbone de l’université dans ce domaine.
Enfin, le troisième périmètre, englobant les émissions indirectes, révèle que les déplacements quotidiens des étudiants et du personnel génèrent 10 807 t éq. CO2. À cela s’ajoutent les voyages professionnels, qui contribuent pour 2 735 t éq. CO2. Cependant, le poids le plus lourd dans le bilan carbone provient des approvisionnements en biens et services, qui affichent une décharge environnementale de 21 056 t éq. CO2.
Une feuille de route vers la carboneutralité
Ce premier bilan est une étape cruciale pour l’UdeM, car il établit une base de référence pour les efforts futurs en matière de réduction des émissions. Selon Stéphane Béranger, coordonnateur au développement durable, l’université a fixé des objectifs clairs et ambitieux : une réduction globale de 20% des émissions des périmètres 1 et 2 d’ici 2025 par rapport à l’année de référence 2004-2005, suivie d’une baisse de 40% d’ici 2030, avec l’objectif ultime d’atteindre la carboneutralité en 2040.
Le choix de 2004-2005 comme année de référence est significatif, puisqu’il concorde avec les engagements du Canada suite à l’Accord de Paris, soulignant ainsi l’intention de l’université de se conformer aux normes internationales dans la lutte contre le changement climatique.
Stratégies pour réduire les émissions
Pour parvenir à ces objectifs ambitieux, l’UdeM compte principalement sur l’électrification du chauffage. Cela implique le remplacement des chaudières à gaz naturel par des chaudières électriques, notamment celles situées à la centrale thermique et au pavillon Marie-Victorin. Cette transition pourrait permettre une réduction significative des émissions de l’ordre de 5 000 t éq. CO2.
En parallèle, l’université a mis en place un fonds carbone dans le but de compenser les émissions de GES issues des déplacements professionnels du personnel. Ce fonds est conçu pour soutenir des initiatives qui contribuent à la restauration de l’environnement et à la réduction de l’empreinte carbone globale.
Une méthodologie rigoureuse utilisée pour la collecte des données
Un aspect essentiel du succès de ce bilan repose sur la collecte de données précises. Les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan ont été réunies par les différentes unités responsables des campus de l’UdeM. Cela inclut le campus principal de la montagne, ainsi que ceux de Saint-Hyacinthe et Laval, le campus MIL, et la Station de biologie des Laurentides. Ces données ont ensuite été analysées par l’Unité du développement durable, qui a soumis le rapport au vérificateur externe Enviro-accès pour garantir l’objectivité et l’exactitude des résultats.
Une initiative alignée avec d’autres établissements d’enseignement supérieur
Les résultats du bilan carbone de l’UdeM se situent dans la moyenne des établissements d’enseignement supérieur au Québec, avec des chiffres qui sont comparables à ceux d’autres universités comme McGill, l’Université de Sherbrooke, et l’Université Laval. Selon les experts, un tel bilan est essentiel pour instaurer des bases solides qui permettront de mesurer les progrès et d’adapter les stratégies de réduction des émissions à l’avenir.
Un engagement envers l’éducation et la sensibilisation
En plus de ses efforts de réduction des émissions, l’UdeM prend également des mesures pour sensibiliser sa communauté. L’Unité du développement durable a développé une application mobile gratuite, Votre empreinte, qui permet à chacun de calculer son empreinte carbone. L’application aide les utilisateurs à comprendre et à mesurer les émissions de GES résultant de leurs déplacements ainsi que de leurs choix alimentaires.
Cette initiative vise à encourager les usagers à prendre conscience de leurs comportements et à admettre l’impact collectif que ces actions ont sur l’environnement.
Le futur du développement durable à l’UdeM
La publication du premier bilan carbone est un moment charnière pour l’UdeM, marquant le début d’une transition écologique ambitieuse qui vise à intégrer les principes de durabilité dans toutes ses opérations. Avec des objectifs clairs et des stratégies définies, l’université est déterminée à jouer un rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique, en avançant vers une plus grande responsabilité environnementale.
Les efforts déployés jusqu’à présent témoignent de la volonté de l’université de non seulement se conformer aux standards actuels, mais aussi d’innover pour répondre aux défis environnementaux grandissants. Les prochaines étapes de cette démarche incluront la mise en œuvre des recommandations issues du bilan, ainsi que l’élargissement des initiatives en faveur de la durabilité.
Conclusion provisoire sur les avancées vers la carboneutralité
En conclusion, l’Université de Montréal montre un engagement indéfectible par la réalisation de ce premier bilan carbone, offrant un cadre pour des actions futures. Ce processus est essentiel pour assurer que les initiatives de développement durable de l’université soient non seulement approfondies, mais aussi véritablement impactantes face aux enjeux environnementaux mondiaux. Sa position en tant qu’établissement d’enseignement supérieur innovant et responsable est désormais solidifiée, et elle continuera à contribuer positivement à la lutte contre les changements climatiques.

Témoignages sur le bilan carbone inaugural de l’Université de Montréal
Le lancement du premier bilan carbone de l’Université de Montréal marque une étape significative dans la lutte contre les changements climatiques. Pour certains étudiants, ce rapport est une preuve tangible de l’engagement de l’université envers la durabilité. « Je suis fier de voir mon établissement prendre ses responsabilités en matière d’environnement. Cela montre que notre école ne se contente pas de discours, elle agit », a déclaré un étudiant en environnement.
Des membres du personnel académique soulignent également l’importance de cette initiative. « Ce bilan est essentiel pour nous orienter dans nos recherches et programmes sur la durabilité. Nous avons besoin de données concrètes pour accompagner nos étudiants et les préparer à relever les défis écologiques », a expliqué une professeure de géographie.
Les employés de l’université sont particulièrement enthousiasmés par les objectifs de réduction des émissions. « Savoir que nous visons une carboneutralité d’ici 2040 encourage chacun d’entre nous à adopter des comportements plus écoresponsables au quotidien », a affirmé un membre du personnel de support.
Enfin, des acteurs communautaires se disent optimistes face à ce bilan. « C’est une avancée qui, nous l’espérons, inspirera d’autres institutions à travers le pays à faire de même. On a besoin d’unir nos efforts pour faire face à l’urgence climatique », a commenté un représentant d’une organisation environnementale locale.